Ihssane EL OMRI, Club de Mediapart, 11/2/2025
L’ auteure est défenseure des droits humains et membre de Transparency International Maroc.
Dans les républiques héréditaires ou les royautés, où le pouvoir s’étend bien au-delà des sphères politiques, l’économie devient souvent l’apanage d’une élite. Ce capitalisme de cour, fondé sur la prédation, le clientélisme et l’accaparement des ressources, façonne des marchés verrouillés et empêche l’émergence d’une concurrence libre et équitable.
La prédation économique ne se réduit pas à une simple inégalité des rapports d'échange. Elle incarne une dynamique où la contrainte supplante le consentement, où la domination s’exerce par l’imposition d’une transaction asymétrique. Comme le souligne Michel Volle [Prédation et prédateurs, 2008], cette relation repose sur un accord biaisé, privant la partie dominée d'une négociation véritablement équilibrée. Le prédateur économique use de sa position de force pour s’approprier des ressources, des avantages ou des richesses, sans que la réciprocité n’entre en ligne de compte.
Les racines de cette dynamique remontent aux premiers temps de la sédentarisation humaine. Avec l’accumulation des premières richesses agricoles et animales, des hiérarchies ont été créées, créant avec elles des rapports de force inédits.
Dans l’Antiquité et au Moyen Âge, l’esclavage illustre cette tendance : il s’agit d’un système d’extraction de richesse où la force et la coercition dictent les termes de l’échange. L’accaparement des terres, le monopole des réserves alimentaires et le contrôle des routes commerciales renforcent ces logiques.
Si les modalités ont changé aujourd’hui, les logiques de prédation persistent sous de nouvelles formes. James K. Galbraith, dans The Predator State (2009) [fr. L’État prédateur, Seuil 2009], analyse comment l’intervention de l’État, présentée comme un mécanisme de stabilisation, sert souvent à consolider le pouvoir d'une élite économique. Dans cette perspective, l'État n’est plus un simple arbitre du marché, mais un acteur central de la redistribution des opportunités. Il façonne les règles du jeu, favorise certaines entités et orchestre les flux de capitaux.
Dans des États où le pouvoir est fortement centralisé et où les institutions démocratiques sont fragilisées, le pouvoir politique exerce souvent une prédation économique en contrôlant directement les ressources naturelles et les secteurs stratégiques. Dans ces Etats, et particulièrement les “républiques héréditaires” et les régimes monarchiques, le système de « capitalisme de connivence » est fréquemment cité : l’État et une élite proche de pouvoir attribuent d’importants contrats publics et gèrent des secteurs clés de manière à extraire des rentes, souvent par le biais de mécanismes opaques et de favoritisme. Les réseaux d’influence verrouillent ainsi l’accès à certains secteurs stratégiques, transformant l’économie en un espace de cooptation plutôt qu’un champ de concurrence ouverte. Dans ces environnements, les nouveaux entrants peinent à émerger, non en raison d’une absence d’innovation ou de compétitivité, mais parce que les règles du jeu sont biaisées en faveur des acteurs déjà en place. Ces derniers bénéficient d’un maillage institutionnel et relationnel qui leur permet de conserver un avantage indéfectible, façonnant ainsi une économie où les opportunités sont distribuées selon des logiques d’appartenance et de fidélité plutôt que selon celles du marché.
Les monarchies dites patrimoniales, dans le sens de Weber, sont caractérisées par une absence de distinction claire entre les ressources de l'État et les biens privés du monarque. Dans ces systèmes, l'administration et l'économie deviennent des extensions du pouvoir personnel du souverain, ce qui favorise la captation des richesses nationales à des fins privatives. Cette configuration institutionnelle contraste avec les systèmes démocratiques modernes, où des mécanismes de reddition des comptes limitent les risques d'appropriation indue des ressources publiques. Dans un cadre monarchique autoritaire, l'accumulation du capital économique et politique par le monarque et ses proches s'opère sans contrôle effectif. La concentration du contrôle de ces ressources entre les mains du souverain et de son entourage empêche une redistribution équitable et limite la diversification économique.
Les théories de l'économie politique rentière suggèrent que la rente favorise l'émergence d'un État prédateur, où les ressources publiques sont redistribuées selon des logiques clientélistes plutôt que productives. Cette situation se traduit par une dépendance économique à la rente et par un empêchement du développement du secteur privé indépendant.
Ces nouvelles formes de prédation transforment le capitalisme en un système où l'accès aux ressources est conditionné non plus par le mérite, mais par l’alignement sur les structures de pouvoir. Loin de favoriser une dynamique d’innovation et de compétition saine, ce modèle perpétue une économie de rente où la réussite repose davantage sur la proximité avec les cercles influents que sur la création de valeur ajoutée réelle. Il en résulte une stagnation des forces productives et un ralentissement du renouvellement économique, tandis que les inégalités se creusent, les élites consolidant leurs positions au détriment du tissu entrepreneurial et de la mobilité sociale.
La prédation économique, loin d'être un archaïsme, s'est adaptée aux réalités contemporaines en se perfectionnant. Hier, elle s'incarnait dans la confiscation des surplus agricoles et l'esclavage ; aujourd'hui, elle opère à travers la capture des institutions, le monopole des flux financiers et la fabrication de la rareté.


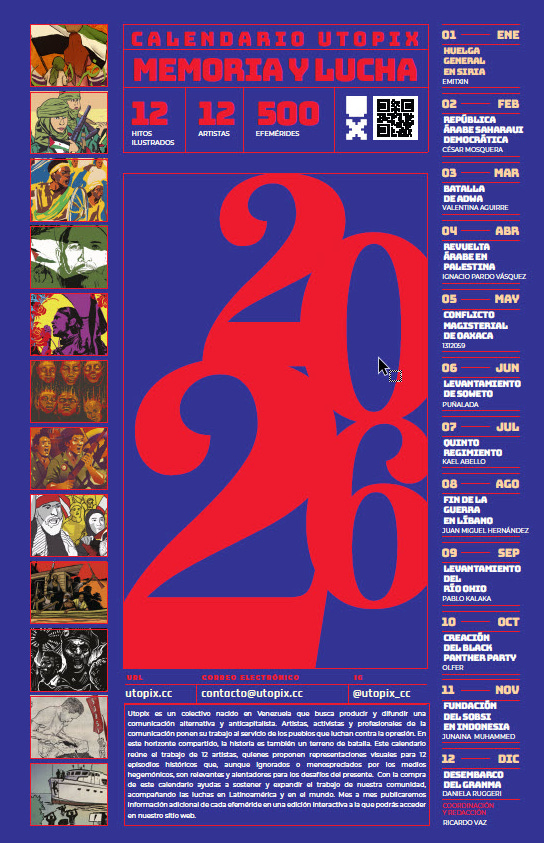
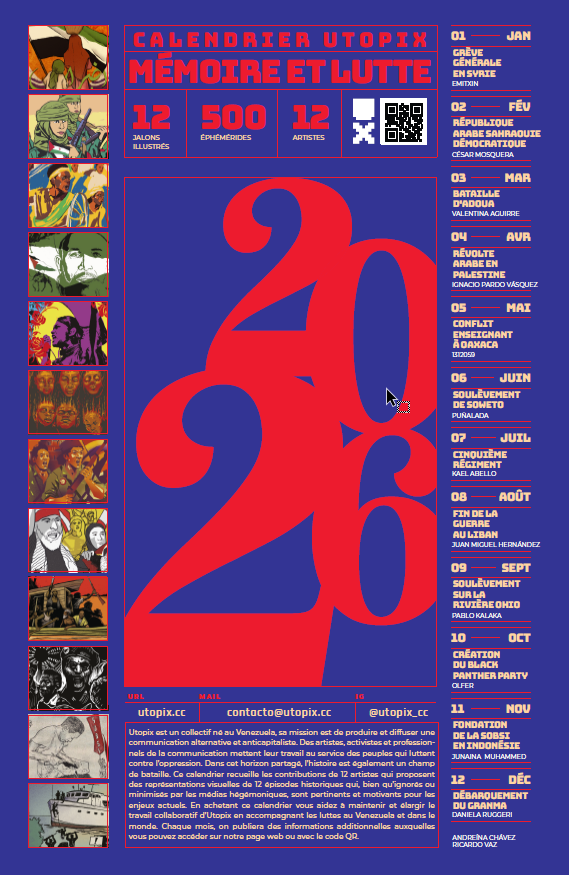
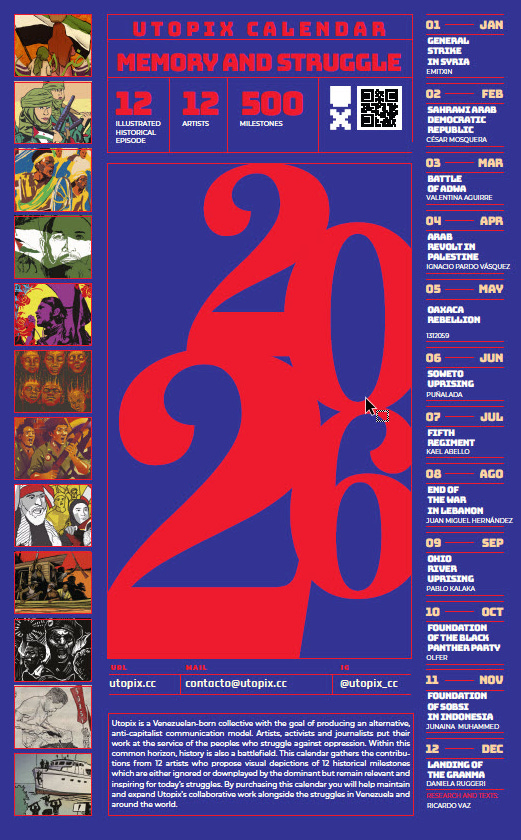


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire