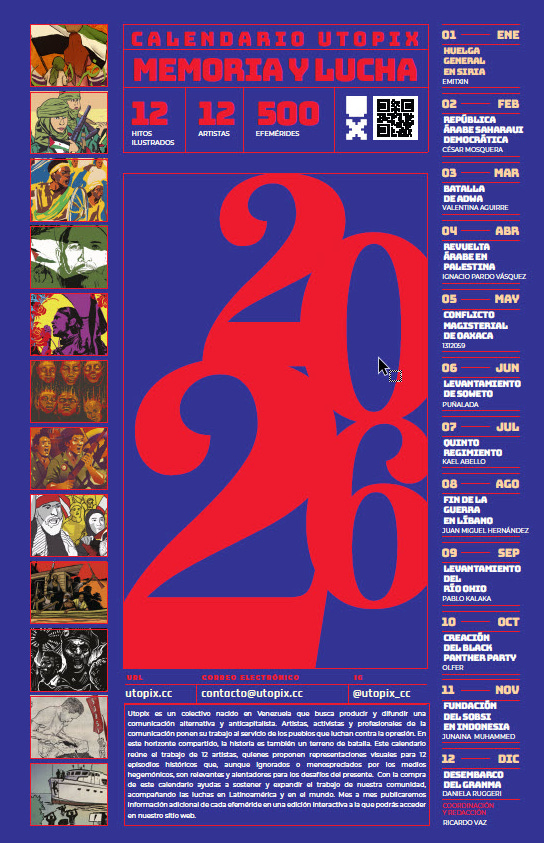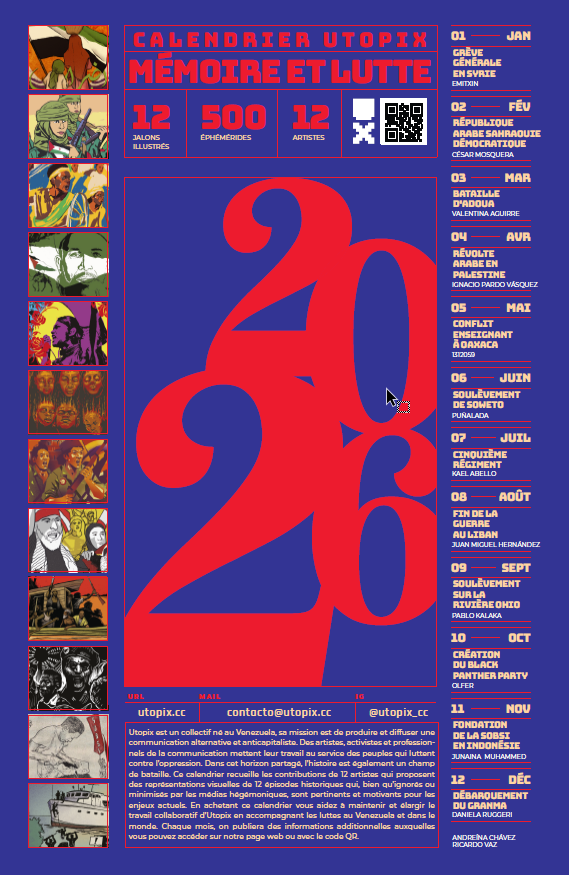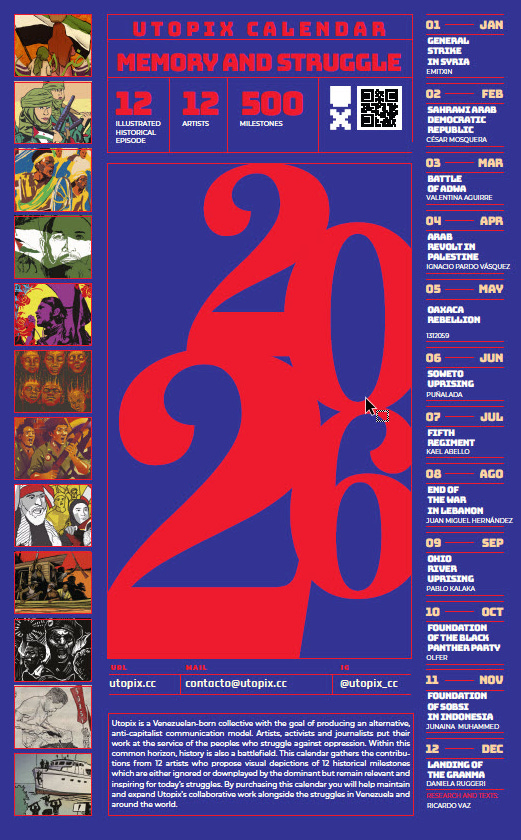Aurel Sèdjro Houenou. Édité par Wilfried ASSOGBA (Agence Ecofin) , 28/1/2026
Au Maroc, la compagnie minière canadienne Aya Gold & Silver prévoit de consacrer environ 60 millions de dollars américains à l’exploration de ses projets aurifères et argentifères de Zgounder et Boumadine en 2026. Ce financement annoncé dans une mise à jour publiée le mardi 27 janvier, vise à soutenir les travaux engagés pour « accroître les ressources et soutenir les options à long terme » de ces actifs.
Aya n’a pas détaillé la répartition de ce budget par projet, mais l’essentiel des travaux d’exploration prévus devrait se concentrer sur Boumadine. La société y programme un total de 200 000 mètres de forage sur l’année, avec pour objectif d’accroître les ressources et renforcer la crédibilité de son potentiel minéral. À Zgounder, 20 000 mètres de forage sont également prévus sur des cibles situées à proximité de la mine existante.
Développer de nouvelles opportunités de croissance
À travers ces initiatives, Aya Gold & Silver entend ainsi soutenir ses ambitions de croissance au Maroc. À Zgounder, où une production annuelle de 4,82 millions d’onces d’argent a été déclarée en 2025, elle entrevoit encore un potentiel de croissance, tablant sur une moyenne de 6 millions d’onces par an jusqu’en 2036. Une perspective susceptible d’être soutenue par l’identification de nouvelles cibles prometteuses sur le site lors des travaux d’exploration, ouvrant la voie à une potentielle extension de la durée de vie.
Du côté de Boumadine, qu’il cherche à faire avancer comme sa prochaine mine dans le royaume chérifien, le groupe voit également plus grand. Selon une étude économique préliminaire (PEA) publiée en novembre 2025, cet actif peut produire 2,3 millions d’onces d’or et 69,8 millions d’onces d’argent en 11 ans, auxquels s’ajouteraient du zinc et du plomb en sous-produits. Ce potentiel est déjà en cours d’optimisation, notamment à travers une mise à jour des ressources attendue au second semestre 2026, qui devra également servir de base à l’actualisation de l’étude.
« Nos objectifs sont axés sur l’optimisation continue de la mine d’argent de Zgounder […], l’accélération des études de faisabilité à Boumadine et la mise en œuvre d’un ambitieux programme d’exploration. Ensemble, ces initiatives couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur et visent à renforcer la capacité de production, à accroître les ressources et à développer de nouvelles opportunités », explique Benoit La Salle, président d’Aya Gold & Silver.
Pour l’heure, les modalités de mobilisation du financement prévu n’ont pas été précisées. La société souligne néanmoins disposer d’un « bilan solide », après une année 2025 marquée par la hausse des volumes commercialisés à Zgounder et par la progression soutenue des prix de l’argent. Cette dynamique se poursuit en 2026, les cours s’échangeant actuellement au-delà de 105 dollars l’once, soit une hausse de 48 % depuis le début de l’année, selon Trading Economics.
Un contexte de prix élevés qui permet d’offrir aux sociétés minières une fenêtre favorable pour accélérer leurs travaux et affiner leurs projets. Il reste à observer comment Aya capitalisera sur cette conjoncture pour faire progresser ses opérations au Maroc.
NDLR SOLIDMAR
- Mine de Zgounder (Argent) : Située dans le Jebel Siroua (Anti-Atlas), à environ 260 km à l'est d'Agadir, dans la province de Taroudant. Elle est accessible depuis Taliouine via Askaoun.
- Projet Boumadine (Polymétallique) : Situé dans la province d'Errachidia, dans le sud-est du Maroc.
- Géologie : Les deux gisements sont situés le long de la "faille de l'Anti-Atlas".
Points Forts 2025-2026
- Zgounder : La production a connu une forte hausse (+193% début 2025). Une extension "Far East" est en exploration active.
- Boumadine : L'exploration a identifié de nouvelles zones à haute teneur (Asairem, Imariren).
Lire aussi :
14/01/2026 - Au Maroc, la production de la mine d’argent Zgounder en hausse de 193 % en 2025
17/12/2025 - Au Maroc, Aya vise 6 millions d’onces d’argent par an à Zgounder jusqu’en 2036
21/11/2025 - Au Maroc, Aya veut financer le projet d’argent Boumadine, avec des stocks historiques