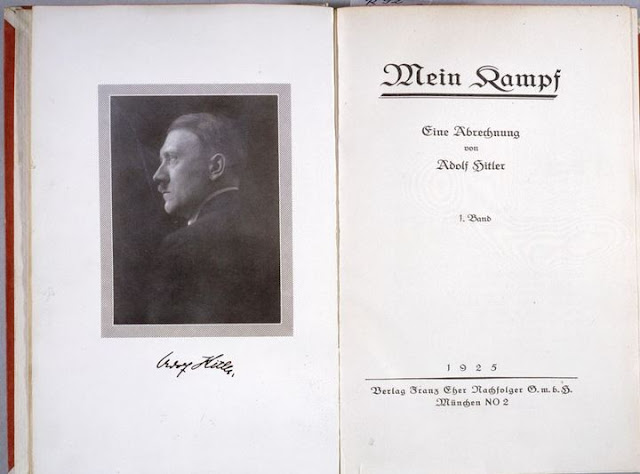L’article ci-dessous du
chercheur palestino-usaméricain Joseph Massad, datant du mois de mai dernier, met
en lumière la logique historique derrière la nouvelle attaque israélienne
contre la Syrie
Joseph Massad, Midle East Eye,
6/5/2025
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala
De la Palestine de l’époque du
mandat britannique à la Syrie post-Assad d’aujourd’hui, les dirigeants
sionistes ont ciblé les communautés druzes pour fragmenter la société arabe et
enraciner un ordre colonial de peuplement.
Des
soldats israéliens empêchent une famille druze syrienne de s’approcher de la
frontière près de Majdal Shams, sur le plateau du Golan occupé par Israël, le 3
mai 2025 (Jalaa Marey/AFP)
La semaine dernière (fin avril
2025), l’ armée israélienne a pris du temps sur son programme chargé d’extermination des
Palestiniens de
Gaza , de bombardement et de tirs sur les Palestiniens à travers la
Cisjordanie, de bombardement du Liban et
de lancement d’une série de bombardements sur le territoire syrien - dont
la capitale Damas - pour lancer une série de bombardements très spéciaux .
Le dernier raid aérien visait ce
qu’Israël a présenté comme « un groupe extrémiste » qui avait attaqué des
membres de la communauté druze syrienne, qu’Israël avait « promis » de défendre
en Syrie même.
Après la chute du régime de l’ancien
président Bachar al-Assad provoquée en décembre dernier par Hay’at Tahrir
al-Cham (HTS), ancienne branche d’Al-Qaïda, des violences sectaires liées à l’État
ont éclaté contre les Alaouites et les Druzes syriens . Les minorités religieuses se sentent
assiégées et craignent de plus en plus l’avenir.
Malgré les assurances du
président syrien autoproclamé par intérim et ancien
commandant d’Al-Qaïda , Ahmed al-Charaa, selon lesquelles les
minorités religieuses seraient protégées, le régime a déjà commencé à imposer
des restrictions « islamistes sunnites » sur de nombreux aspects de la société,
y compris les programmes scolaires et la ségrégation des
sexes dans les transports publics .
Pendant ce temps, la violence
sectaire perpétrée par des groupes liés à l’État et des milices non
étatiques persiste .
Haut du
formulaire
Bas du
formulaire
C’est dans le contexte de cette
violence sectaire qu’Israël a vu une opportunité de poursuivre un programme que
le mouvement sioniste poursuivait depuis les années 1920 : créer de nouveaux
schismes, ou exploiter les schismes existants, entre les groupes religieux en
Palestine et dans les pays arabes environnants, dans une stratégie classique de
diviser pour mieux régner.
Cette politique israélienne
continue vise à donner une plus grande légitimité à la prétendue raison d’être
d’Israël – non pas en tant que colonie sioniste européenne servant les intérêts
impériaux européens et usaméricains, mais en tant qu’État sectaire religieux
dont le modèle devrait être reproduit dans tout le Moyen-Orient, en divisant
les groupes religieux autochtones en petits États distincts pour « protéger »
les minorités.
Plan sectaire
Israël estime que la
normalisation des relations dans la région ne peut se faire que si de tels
États sectaires sont créés, notamment au Liban et en Syrie.
Dès les années 1930, les
dirigeants israéliens s’allièrent aux sectaires maronites
libanais et, en 1946, ils signèrent un accord politique avec l’Église
maronite sectaire.
Leur soutien ultérieur à des
groupes chrétiens fascistes libanais, comme les Phalangistes – qui cherchaient
à établir un État maronite au Liban – s’inscrivait dans les plans sionistes
pour la communauté druze palestinienne. Cette stratégie a débuté dans les
années 1920, lorsque les colons sionistes ont commencé à cibler la population
druze palestinienne.
Au lendemain de la Première
Guerre mondiale et suite au soutien britannique au
colonialisme de peuplement sioniste en Palestine, les dirigeants sionistes ont
lancé des efforts pour créer des divisions sectaires entre chrétiens et
musulmans palestiniens.
Les Palestiniens, cependant,
étaient unis dans leur opposition au sionisme et à l’occupation britannique à
travers les « Associations musulmanes-chrétiennes », établies en
1918 comme instruments institutionnels d’unité nationale et de résistance au
régime colonial.
Un projet sioniste connexe visait
à isoler la petite communauté religieuse druze palestinienne afin de la
cultiver comme un allié potentiel.
Au début du mandat britannique en
1922, les Druzes palestiniens étaient au nombre de 7 000 , vivant dans 18 villages à travers la Palestine
et représentant moins d’un pour cent des 750 000 habitants du pays.
Mythologie coloniale
Les puissances coloniales s’appuyaient
souvent sur des mythologies raciales pour diviser les populations autochtones.
Alors que les Français affirmaient que les Berbères algériens descendaient des
Gaulois pour les distinguer de leurs compatriotes arabes, les Britanniques
présentaient les Druzes comme des descendants des Croisés, les décrivant comme
une « race blanche plus ancienne » non arabe et « une race beaucoup plus propre et plus belle » que les
autres Palestiniens, en raison de la prédominance de la peau claire et des yeux
bleus parmi eux.
Bien que les Druzes aient été
initialement considérés comme trop marginaux pour être embrigadés, à la fin des
années 1920 et au début des années 1930, les dirigeants sionistes ont mené une
campagne concertée pour les intégrer.
Tout comme ils avaient exploité
les rivalités entre les familles palestiniennes importantes de Jérusalem –
les Husayni et les Nashashibi – les sionistes ont cherché
à faire de même avec les Druzes, en encourageant le factionnalisme entre
les Tarifet les Khayr , et en promouvant une identité
sectaire particulariste.
Dans les années 1920, les
autorités d’occupation britanniques ont instauré un système sectaire en
Palestine pour servir la colonisation juive européenne – un système qui
séparait la communauté druze palestinienne du reste du peuple
palestinien.
Aux côtés des sionistes, les
Britanniques ont encouragé le factionnalisme et le communautarisme religieux –
des efforts qui ont abouti à la fondation de la Druze Union Society sectaire en 1932, aux côtés de
nouvelles sociétés musulmanes et chrétiennes orthodoxes formées à la même
période dans le sillage de la politique britannique.
La même année, les efforts
sionistes pour coopter les dirigeants druzes s’intensifient, se concentrant sur
une faction en particulier et encourageant son sectarisme.
Cela provoqua des affrontements
entre les différentes factions druzes en 1933, mais la famille nationaliste Tarif conserva son leadership et
vainquit la faction collaborant avec les sionistes. Ces derniers espéraient que
la cooptation des Druzes palestiniens ouvrirait la voie à des alliances avec
les populations druzes plus importantes de Syrie et du Liban.
Tactiques anti-révolte
Dans la seconde moitié des années
1930, pendant la Grande Révolte palestinienne contre l’occupation britannique
et la colonisation sioniste européenne (1936-1939), les sionistes et les
Britanniques ont intensifié leur campagne sectaire pour empêcher les
Palestiniens druzes de rejoindre le soulèvement anticolonial.
À cette fin, ils enrôlèrent Cheikh Hassan Abou Rukun , chef de faction druze du
village palestinien d’Isfiya, à une époque où des Druzes de Palestine, de Syrie
et du Liban avaient rejoint la révolte . En novembre 1938, Abou Rukun
fut tué par les révolutionnaires palestiniens en tant que
collaborateur, et son village fut attaqué pour expulser d’autres
collaborateurs.
Les sionistes ont exploité son assassinat dans leur campagne
sectaire visant à embrigader la communauté druze, affirmant qu’il était ciblé
parce qu’il était druze plutôt que parce qu’il était un collaborateur.
En fait, pendant la révolte
palestinienne, les révolutionnaires ont tué environ 1 000 collaborateurs palestiniens – la plupart d’entre
eux étaient des musulmans sunnites, dont beaucoup étaient issus de familles
importantes.
Alors même que les sionistes
travaillaient assidûment à répandre le sectarisme parmi les communautés druzes
de Palestine, de Syrie et du Liban, à la fin de 1937, ils prévoyaient
simultanément d’expulser toute la population druze - alors au nombre de 10 000
personnes - de l’État juif projeté par la Commission Peel britannique , puisque tous les villages druzes se trouvaient à l’intérieur
des frontières que celle-ci recommandait.
Pendant ce temps, les autorités d’occupation
britanniques ont fait avancer leur projet sectaire en payant certains dirigeants druzes pour qu’ils s’abstiennent
de participer à la révolte.
Schémas de transfert
En 1938, les sionistes établirent
des relations avec le chef anticolonial druze syrien Sultan al-Attrache , dont la révolte de 1925-1927
contre le régime français avait été réprimée dix ans plus tôt. Ils proposèrent
à al-Attrache le « plan de transfert » – l’expulsion de la communauté
druze palestinienne, présentée comme un moyen de la protéger des attaques des
révolutionnaires palestiniens.
Al-Attrache n’acceptait que la
migration volontaire de ceux qui cherchaient refuge, mais refusait tout accord d’amitié avec les sionistes.
Pour atteindre al-Attrache, les
sionistes ont fait appel à l’un de leurs contacts, Yusuf al-’Aysami , un ancien assistant druze syrien
qui avait été en exil en Transjordanie dans les années 1930. Pendant son exil,
il a rendu visite aux Druzes palestiniens et a établi des liens avec les
sionistes.
En 1939, Haïm Weizmann, chef de l’Organisation sioniste,
était favorable à l’idée d’expulser les Druzes. L’émigration
« volontaire » de 10 000 Palestiniens – qui, selon lui,
« seraient sans doute suivis d’autres » – offrait une précieuse opportunité de
faire progresser la colonisation européenne juive en Galilée, région du nord de
la Palestine.
Le financement de l’achat de
terres druzes ne se matérialisa cependant jamais. En 1940, la réconciliation entre certaines familles druzes et
les révolutionnaires palestiniens allégea la pression sur les dirigeants druzes et ébranla le pari initial des
sionistes sur la communauté.
En 1944, l’organisation de
renseignement sioniste (alors connue sous le nom de « Shai ») et le syrien al-’Aysami
ont élaboré un plan visant à transférer les Druzes en Transjordanie et à
financer l’établissement de villages là-bas en échange de toutes les terres
druzes en Palestine.
Les sionistes envoyèrent même une
expédition d’exploration à l’est de Mafraq, en Transjordanie, pour mettre en œuvre le
projet. Cependant, face à l’opposition des Druzes et des Britanniques, le
projet échoua fin 1945. Néanmoins, en 1946, les sionistes réussirent à acquérir
des terres appartenant aux Druzes en Palestine par l’intermédiaire de
collaborateurs locaux.
Embrigadement
En décembre 1947, davantage de
Druzes palestiniens rejoignirent la résistance, alors même que les
sionistes et les collaborateurs druzes s’efforçaient de maintenir la neutralité de la communauté ou de la recruter du côté
sioniste.
En fait, les Druzes de Syrie et
du Liban ont rejoint la résistance palestinienne à la conquête
sioniste en 1948.
En avril 1948, les combattants de
la résistance druze palestinienne ont riposté contre la colonie juive de Ramat Yohanan en réponse à l’attaque d’un colon contre
une patrouille druze et ont subi de lourdes pertes .
Cependant, malgré les victoires
sionistes, la désertion et le désespoir parmi les combattants druzes ont donné
aux agents de renseignement sionistes – parmi lesquels le leader sioniste
ukrainien Moshe Dayan - et aux collaborateurs druzes l’occasion de
recruter des transfuges druzes .
Lorsque la colonie israélienne
fut établie en 1948, l’un de ses premiers actes fut d’institutionnaliser les
divisions au sein du peuple palestinien en inventant des identités ethniques
fictives, dessinées selon des lignes religieuses et sectaires.
À ce stade, l’État israélien a
reconnu les Druzes palestiniens – alors au nombre de 15 000 – comme une secte religieuse « distincte » des
autres musulmans et a établi des tribunaux religieux distincts pour eux.
Peu après, Israël a commencé à
qualifier la population druze de « Druze » plutôt que d’« Arabe »,
tant sur le plan ethnique que national. Pourtant, à l’époque comme aujourd’hui,
celle-ci a continué à subir la même discrimination raciale et l’oppression de
type suprémaciste juif que tous les Palestiniens d’Israël, y compris l’ appropriation de leurs terres.
À ce moment-là, avec le soutien
de l’État israélien, les collaborateurs druzes avaient pris le dessus au sein
de la communauté. Certains de leurs dirigeants ont même appelé le gouvernement
à enrôler des Druzes dans l’armée israélienne – une
offre qu’Israël a dûment acceptée, même si les soldats druzes restent interdits
de rejoindre les unités « sensibles ».
Résistance druze
Malgré la cooptation par l’État
israélien de nombreux membres de la communauté druze, la résistance à la
colonisation s’est poursuivie à un rythme soutenu.
Le poète druze palestinien Samih al-Qasim (1939-2014) demeure l’une des trois
figures les plus célèbres du panthéon palestinien des poètes connus pour leur
résistance au sionisme (les deux autres étant Tawfiq Zayyad et Mahmoud
Darwish). Son œuvre est non seulement largement récitée dans la société
palestinienne, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Palestine, mais nombre
de ses poèmes ont été mis en musique par des chanteuses telles que Kamilya Jubran et Rim al-Banna .
Parmi les autres figures
littéraires et universitaires druzes palestiniennes de premier plan à l’avant-garde
de la résistance au sionisme et au colonialisme israélien figurent le romancier
Salman Natour (1949-2016) ; le poète contemporain Sami Muhanna, qu’Israël a
emprisonné à plusieurs reprises pour ses opinions politiques ; le regretté
érudit Sulayman Bashir (1947-1991) qui a écrit sur l’histoire des relations de
l’URSS avec le nationalisme palestinien et les « communistes » juifs sionistes
; et l’historien Kais Firro (1944-2019), connu pour ses histoires de la
communauté druze.
La tentative actuelle d’Israël de
coopter les dirigeants druzes syriens vise à reproduire ce qu’il a déjà réussi
avec les collaborateurs druzes palestiniens.
Cependant, les dirigeants druzes syriens résistent à cette offensive israélienne en affirmant
faire partie intégrante du peuple syrien, tout en condamnant la politique du nouveau régime « islamiste
» et sectaire.
Pourtant, la volonté d’Israël de
détruire l’unité arabe reste intacte.
Lire aussi
➤La manipulation d’une minorité : l’intervention d’Israël dans l’identité druze, par Amos Barshad