7 avril 1956… Dans l’année 1956, le Maroc a connu des changements en profondeur. A partir de là, il changera d’image, de place dans les stratégies internationales, et sera pris en compte dans le tour de table de la mondialisation. Le 7 avril 1956. L’histoire retiendra cette date comme celle où l’Espagne franquiste, après des décennies de présence et de contrôle sur le territoire marocain, accepta enfin de lever le voile de son protectorat. Si l’indépendance du pays avait été officiellement proclamée un mois plus tôt par la France, restait encore à Madrid de reconnaître l’évidence : le Maroc voulait et allait redevenir pleinement souverain.
Quelle longue épopée que celle de la colonisation ! Il pourrait y avoir autant d’histoires que de conteurs. Mais ne remontons pas à l’aube de 1912. Contentons-nous de faire un petit retour en arrière, jusqu’en 1950. Le Maroc du début des années 50 était une terre bouillonnante. Les luttes nationalistes ne cessaient de croître de gauche à droite, les revendications d’indépendance gagnaient en ampleur et la figure de feu le roi Mohammed V, roi en exil puis de retour triomphal en 1955, cristallisait l’espoir de tout un peuple.
La
France, face à une pression internationale et locale, avait fini par
céder. Le 2 mars 1956, Paris signait un accord historique : le
protectorat français prenait fin.
Une négociation de longue haleine
C’est
dans ce contexte que les discussions entre Rabat et Madrid eurent lieu à
plusieurs reprises. Feu le roi Mohammed V et ses négociateurs, dont son
fils héritier, feu le roi Hassan II, avancèrent leurs pions avec
fermeté. L’argumentaire marocain était imparable : l’unité du territoire
était une nécessité historique et nationale. L’Espagne, affaiblie sur
la scène internationale et soucieuse de maintenir de bonnes relations
avec ses voisins, finit par se résoudre à jeter l’éponge.
L’annonce fit l’effet d’un
coup de tonnerre. Dans les rues des grandes villes marocaines, des
scènes de liesse éclatèrent. Feu le roi Mohammed V, figure tutélaire du
nationalisme marocain, devint plus que jamais le Père de la Nation. Pour
lui, comme pour tout un peuple, cette victoire avait un goût
particulier : celui d’un combat mené avec patience, intelligence et une
volonté inébranlable de rendre aux Marocains leur terre.
L’indépendance formellement acquise, il restait à bâtir une nation moderne. Le Maroc, après plus de 40 ans sous le joug colonial, devait inventer son propre avenir. L’administration, jusqu’alors entre les mains des Français et des Espagnols, devait être entièrement marocanisée.
C’était aussi un défi économique. Pendant la période coloniale, les richesses du pays avaient été largement exploitées au profit des puissances européennes. Il fallait désormais redistribuer les cartes, moderniser l’agriculture, développer l’industrie et assurer une stabilité sociale. Feu le roi Mohammed V, bientôt relayé par feu le roi Hassan II, s’attela à cette tâche titanesque.
Pour ceux qui ont vécu cette période, l’accord
avec l’Espagne prouvait la véritable fin de l’époque coloniale et le
début du Maroc tel qu’on le connaît aujourd’hui.



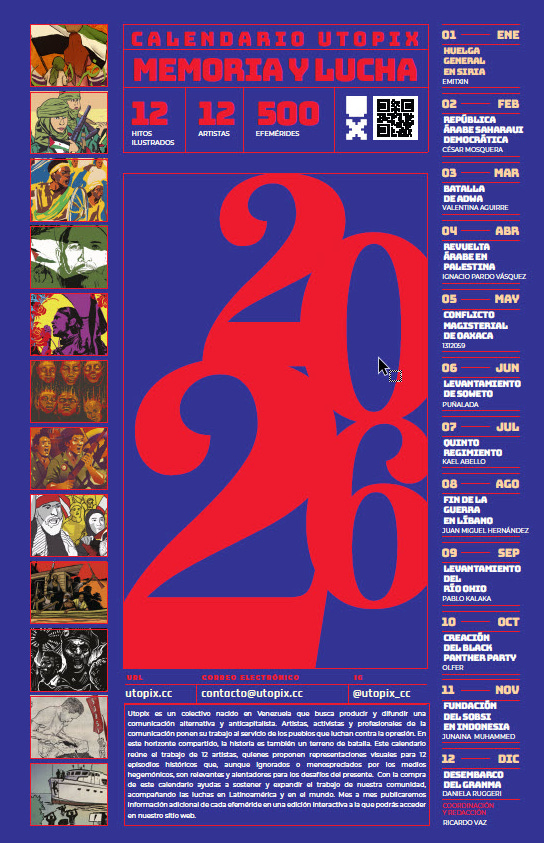
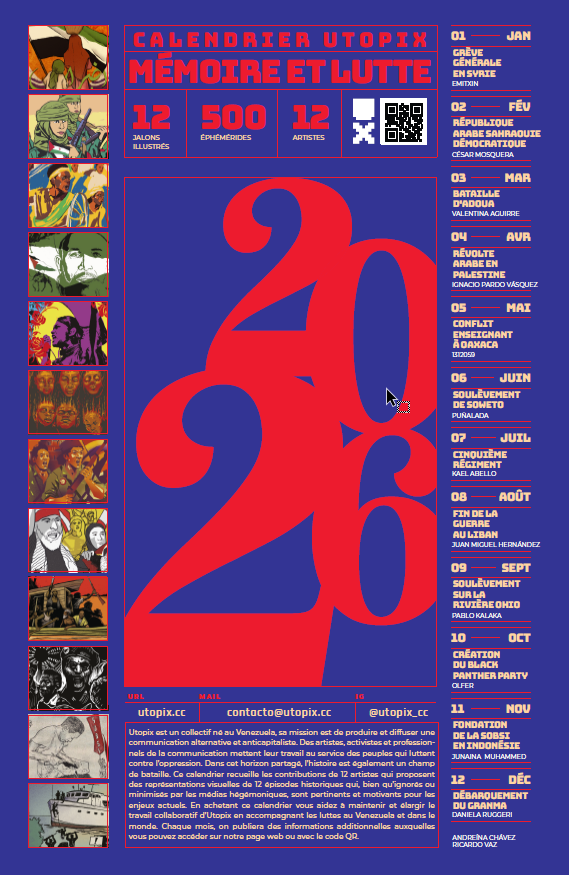
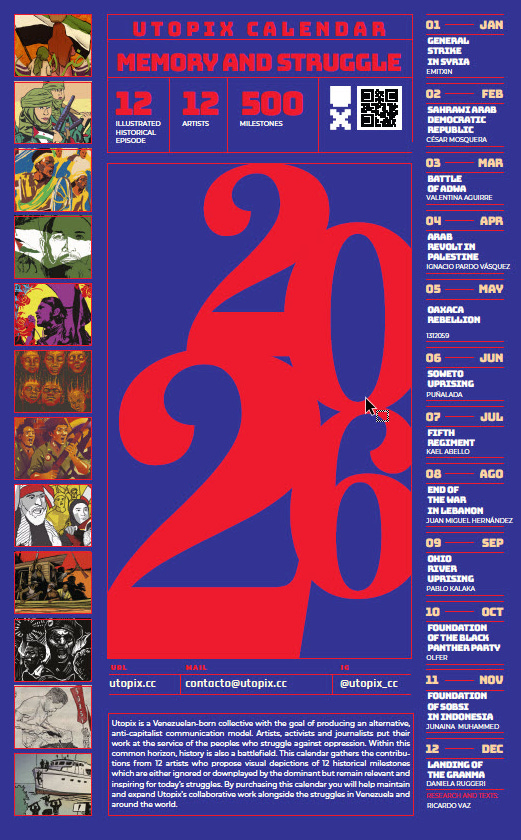


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire