Condamné à la perpétuité en 2009 pour avoir dirigé un réseau terroriste, Abdelkader Belliraj a bénéficié d’une grâce royale à l’occasion de l’Aïd el-Fitr. Une libération qui relance les interrogations autour de cet ancien braqueur, accusé de six assassinats en Belgique et longtemps soupçonné d’avoir navigué entre milieux islamistes et services de renseignement.

Le Belgo-Marocain Abdelkader Belliraj (au centre) arrive au tribunal de Salé, près de Rabat, le 16 octobre 2008, soit huit mois après le démantèlement du réseau terroriste qu’il était soupçonné de coordonner. © EPA/KARIM SELMAOUI/MaxPPP
Condamné à la perpétuité en 2009 pour avoir été à la tête d’un réseau terroriste, Abdelkader Belliraj a bénéficié d’une grâce royale à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de ramadan, ce 31 mars. Ce Belgo-Marocain de 68 ans, qui aura finalement passé dix-sept ans en prison, a été amnistié au même titre que 1 533 condamnés, en détention (1 203) ou en liberté.
Belliraj fait partie d’un groupe de 31 détenus condamnés dans des affaires d’extrémisme ou de terrorisme. Selon un communiqué du ministère de la Justice, ces derniers – dont l’identité n’a pas été dévoilée – ont été graciés après avoir « revu leurs orientations idéologiques et rejeté l’extrémisme ».
Pour rappel, depuis 2015, le Maroc s’est lancé dans une stratégie de déradicalisation institutionnelle, à travers le programme Moussalaha (Réconciliation), piloté par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), en partenariat avec le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et le ministère des Habous. Depuis, plusieurs vagues de grâces royales ont concerné des profils islamistes ou salafistes condamnés pour terrorisme, à condition qu’ils expriment publiquement leur rejet de l’extrémisme. Parmi les « salafistes repentis » les plus connus, graciés en 2016 : Mohamed Fizazi et Abdelwahab Rafiki (Abou Hafs), qui a depuis rejoint le ministère de la Justice.
Si la grâce d’Abdelkader Belliraj retient particulièrement l’attention des médias et de l’opinion publique, c’est que son dossier reste l’un des plus opaques et controversés du contentieux sécuritaire entre le Maroc et la Belgique. Arrêté en janvier 2008 à Marrakech, le Belgo-Marocain avait été condamné l’année suivante à la réclusion à perpétuité. La peine avait ensuite été confirmée en appel. À l’époque, les autorités marocaines l’accusent d’avoir dirigé un réseau terroriste et d’avoir introduit clandestinement des armes dans le royaume, en lien avec un trafic international. Belliraj est également accusé d’avoir commis six assassinats politiques perpétrés en Belgique à la fin des années 1980. Parmi les victimes : l’imam Abdullah al-Ahdal, directeur du Centre islamique et culturel de Bruxelles, son assistant Salem El Bahri, ainsi que Joseph Wybran, président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique.
Belliraj aurait avoué ses « crimes » lors de ses interrogatoires par les services marocains, et déclaré avoir tué pour le compte de Sabri al-Banna, alias Abou Nidal, fondateur du Fatah-Conseil révolutionnaire (mouvement extrémiste palestinien). Mais au cours de son procès, l’accusé a toujours nié en bloc, affirmant que ses aveux auraient été extorqués sous la torture, dans les locaux de la prison secrète de Témara. « Les services marocains ont tout inventé […] Je n’ai pas introduit d’armes à feu au Maroc et nie toute tentative d’actions de ma part visant le renversement du régime », avait-il notamment écrit dans une lettre ouverte publiée sur le site du quotidien belge Le Soir.
De l’extrême gauche à l’internationale islamiste ?
Né à Nador, Abdelkader Belliraj rejoint Bruxelles à l’âge de 14 ans pour y retrouver son père. Dans les années 1980, il milite un temps à l’extrême gauche, avant de graviter dans les cercles pro-iraniens de l’islam politique. Surnommé « El Palesto » par les enquêteurs belges, il se montre actif dans la mouvance chiite et pro-palestinienne. En parallèle, il se forge une réputation dans les milieux interlopes : Belliraj a été condamné pour plusieurs braquages à main armée en Belgique au début des années 2000, une activité qu’il justifiera plus tard comme relevant de la « résistance révolutionnaire », avant de requalifier ces faits comme « des erreurs de jeunesse ». Repéré dès 1986 par la Sûreté de l’État belge, il est surveillé à plusieurs reprises jusqu’à la fin des années 1990.
Lors de son audition au Maroc, Abdelkader Belliraj reconnaîtra avoir été approché par un certain « Patrick », agent belge à qui il aurait promis son aide « en cas de menace contre la sécurité de l’État », tout en précisant que cette collaboration « ne s’est pas faite pour de l’argent ». Une version contredite par plusieurs sources officieuses, pour qui Belliraj aurait fourni des renseignements utiles dans le cadre de dossiers terroristes sensibles, notamment au Royaume-Uni. Mais aucune preuve n’a jamais confirmé son recrutement comme informateur. Et inversement, aucune preuve irréfutable n’est venue établir qu’il était bien le cerveau opérationnel d’un réseau jihadiste international.
En 2015, le volet belge du dossier se referme sur un non-lieu. Dix ans plus tard, Abdelkader Belliraj est finalement gracié au Maroc. Un retour dans l’ombre, alors même que son nom reste associé à une nébuleuse complexe. En 2008, il avait été arrêté dans la ville ocre alors qu’il sortait d’un hôtel appartenant à son frère, Salah Belliraj, lui-même brièvement placé en détention avant d’être gracié un an plus tard. Depuis, Salah, à la tête d’un important patrimoine immobilier au Maroc, est apparu dans une affaire de tentative de spoliation, comme l’a récemment documenté Jeune Afrique. Des zones grises supplémentaires autour d’un dossier qui en compte déjà beaucoup.
Lire sur ce thème
➤Le procès le plus étrange de l’histoire de la justice marocaine
أغــرب محاكمة في تاريخ القضاء المغربي

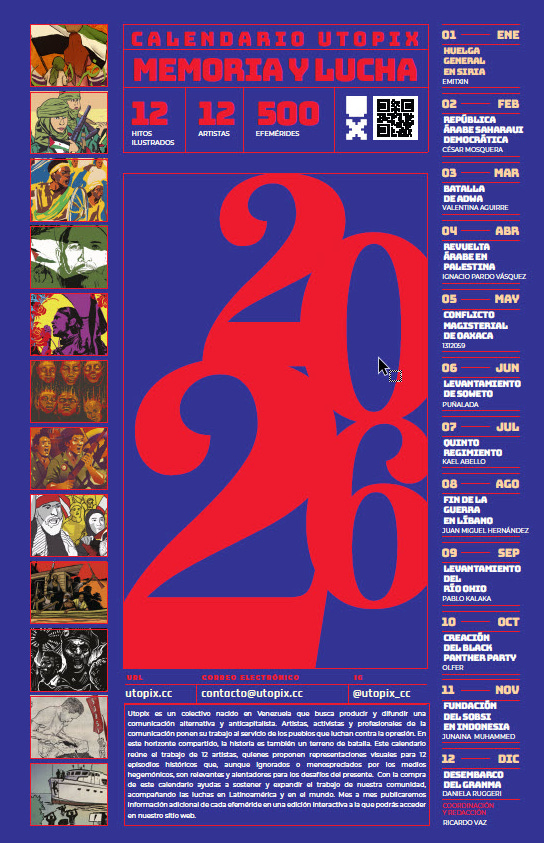
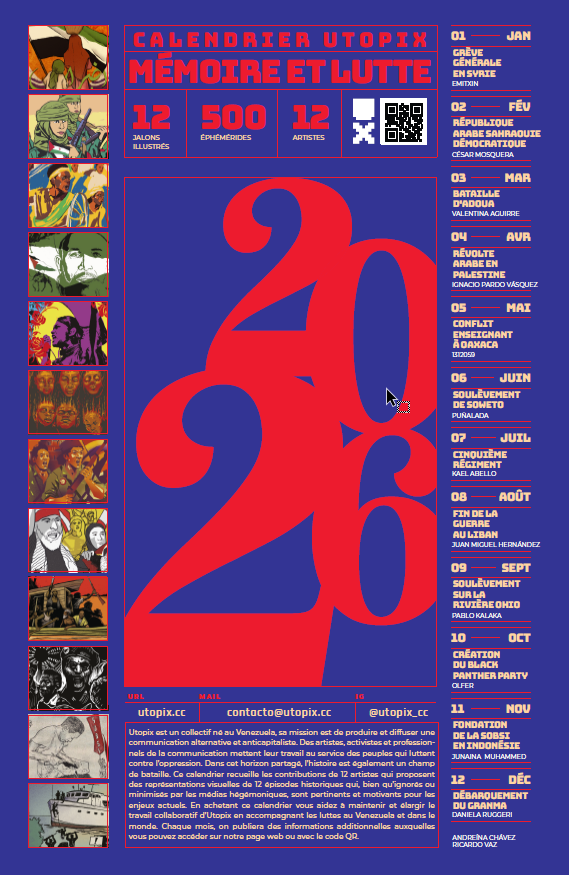
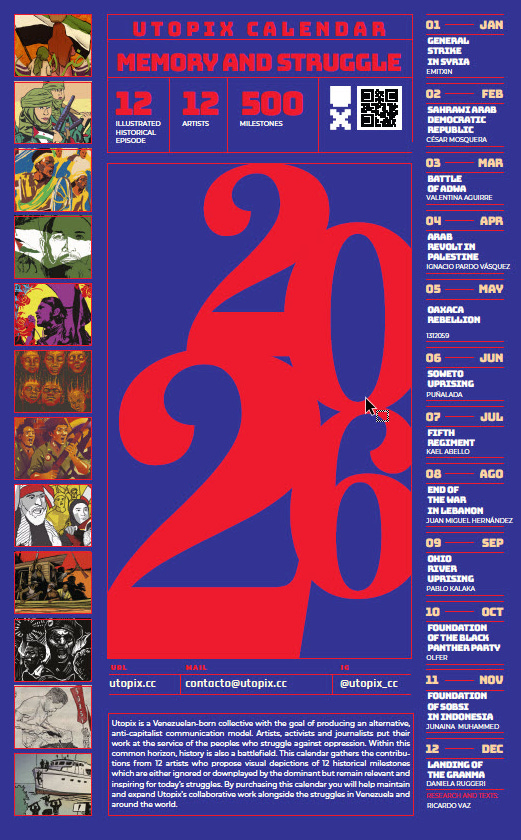


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire