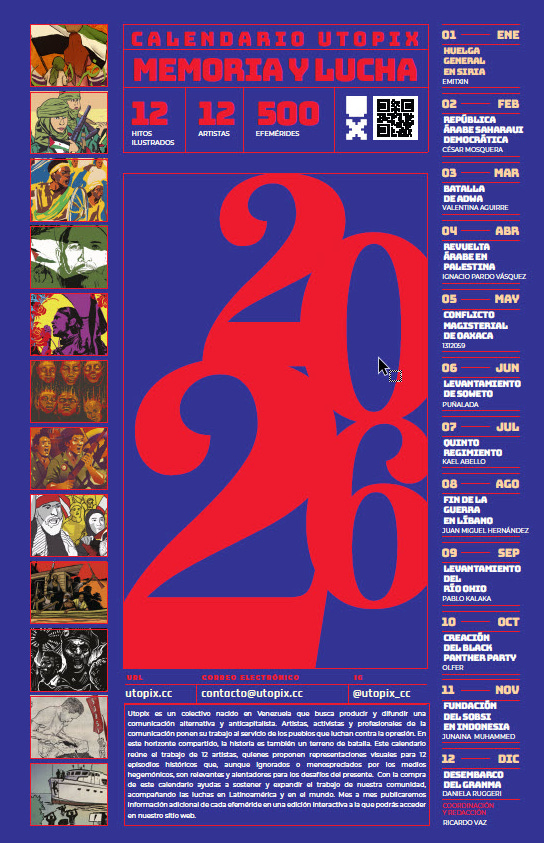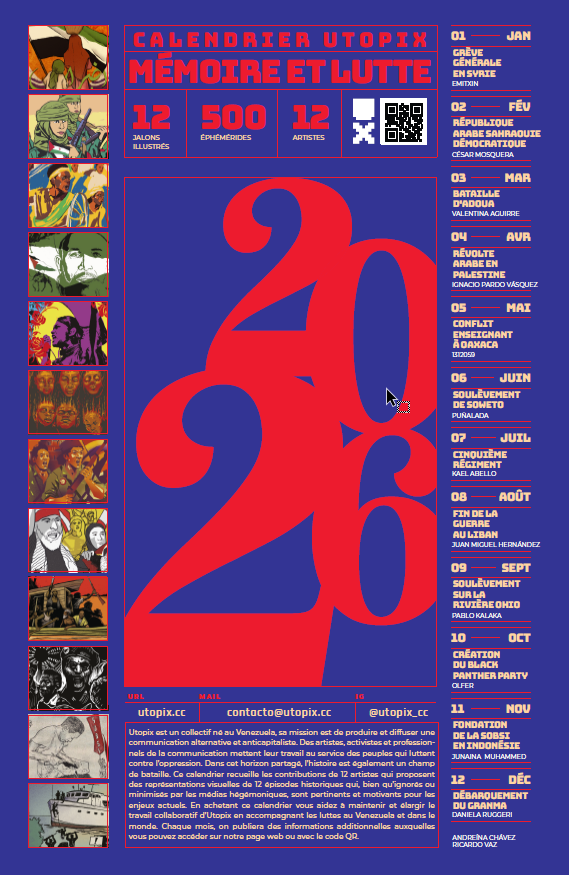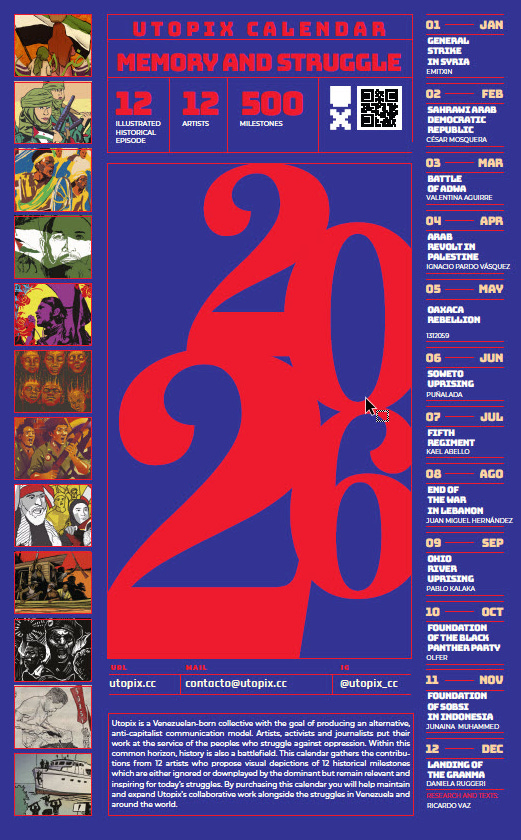En 2024, les demandes de visas Schengen ont atteint un total de 11,716,723 à travers le monde, soit une hausse de 13,5% par rapport à 2023. Selon les données récentes publiées par Schengenvisainfo, cette augmentation témoigne d’un regain d’intérêt pour les déplacements en Europe, après plusieurs années marquées par la pandémie de la Covid-19. Pourtant, les chiffres restent en retrait par rapport aux niveaux atteints en 2019, où près de 17 millions de demandes avaient été enregistrées.
Le Maroc toujours parmi les premiers pays demandeurs
En 2024, le Maroc s’est classé à la quatrième place parmi les cinq premiers pays au monde en nombre de demandes de visa Schengen, derrière la Chine, l’Inde et la Turquie, et juste devant la Russie.
Avec 282.153 demandes déposées uniquement auprès des centres de visa français, le Royaume confirme une tendance durable marquée par une forte mobilité vers l’Europe, notamment pour des motifs touristiques, familiaux, professionnels ou d’études. Cette position reflète également les liens historiques, économiques et humains qui unissent le Maroc à plusieurs pays européens, en particulier la France.
Mais malgré cet engouement, les taux de refus demeurent relativement élevés pour les demandeurs marocains, en particulier en France, où le taux de rejet atteint 15,8%, soit au-dessus de la moyenne de l’espace Schengen (14,8%). Cette situation, bien que légèrement améliorée par rapport à l’année précédente, continue de susciter de l’incompréhension chez de nombreux candidats. Les refus sont parfois perçus comme arbitraires, ce qui renforce un sentiment de traitement inégal, notamment dans les pays d’Afrique du Nord.
Ce volume élevé de demandes marocaines s’inscrit dans un contexte global de reprise des mobilités internationales après la pandémie. Selon Besart Bajrami, fondateur de Schengen Visa Info, le recul global du nombre de demandes par rapport à 2019, année où près de 17 millions de dossiers avaient été déposés, ne s’explique plus par la crise sanitaire. «Le coronavirus n’est plus un facteur. Les restrictions ont été levées depuis un certain temps», affirme-t-il. Pour le Maroc comme pour d’autres pays, d’autres facteurs pèsent désormais sur les décisions des voyageurs, dont les politiques migratoires européennes et les conditions d’obtention des visas.
Visas Schengen : nouvelles modalités à partir du 24 février
France, Espagne et Allemagne restent les destinations préférées
La France demeure le pays le plus sollicité par les candidats au visa Schengen, avec plus de 3 millions de demandes enregistrées en 2024. Elle devance l’Espagne, qui prend la deuxième place avec 1,6 million de demandes, reléguant l’Allemagne à la troisième position avec 1,5 million. Ce trio de tête attire à lui seul une part importante des flux mondiaux, notamment en provenance d’Afrique du Nord et d’Asie.
La France est à nouveau la destination favorite des demandeurs de visa Schengen, avec plus d’un quart des demandes déposées dans le monde entier reçues par ses centres de visa. Parmi ces demandeurs, les Marocains constituent le deuxième groupe le plus important pour l’Hexagone, avec 282.153 demandes, juste derrière les Algériens, qui en ont déposé 352.295.
Si la France reste en tête, elle affiche également le plus grand nombre de refus : 481.139 demandes rejetées, soit un taux de 15,8%, au-dessus de la moyenne européenne. L’Espagne suit avec 244.432 refus (15,7%), tandis que l’Allemagne fait légèrement mieux, avec un taux de refus de 13,7%.
Visa : TLScontact contre la fraude avec une solution automatisée
Sur l’ensemble des pays de l’espace Schengen, le taux moyen de refus s’établit en 2024 à 14,8%, en baisse par rapport à 2023 (16%) et à l’année record de 2022, où il avait atteint 17,9%. Une amélioration perçue comme un signal encourageant pour les voyageurs, mais reste à voir si cette tendance se confirmera en 2025.
Cependant, certains pays continuent de faire face à des taux de refus très élevés. En tête de liste, on retrouve le Bangladesh (54,9%), suivi du Pakistan (47,5%), de la Guinée-Bissau (47%), du Sénégal (46,8%) et d’Haïti (46,3%).