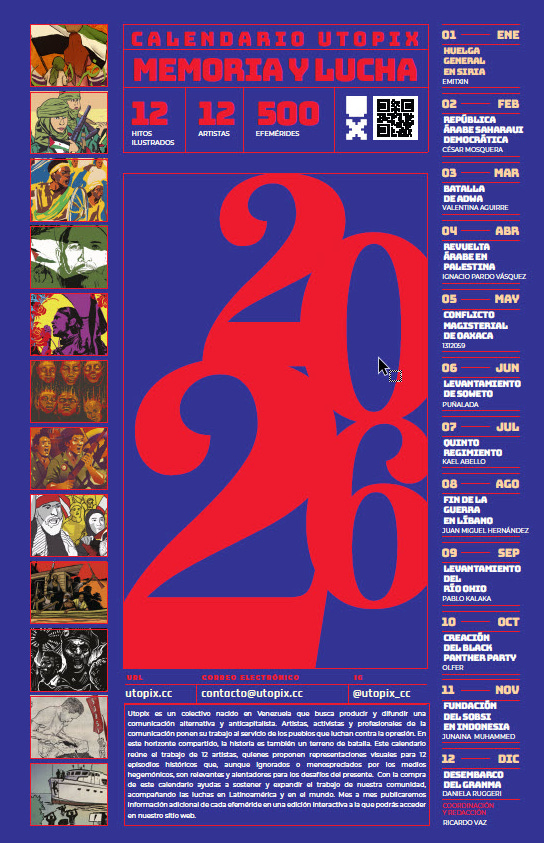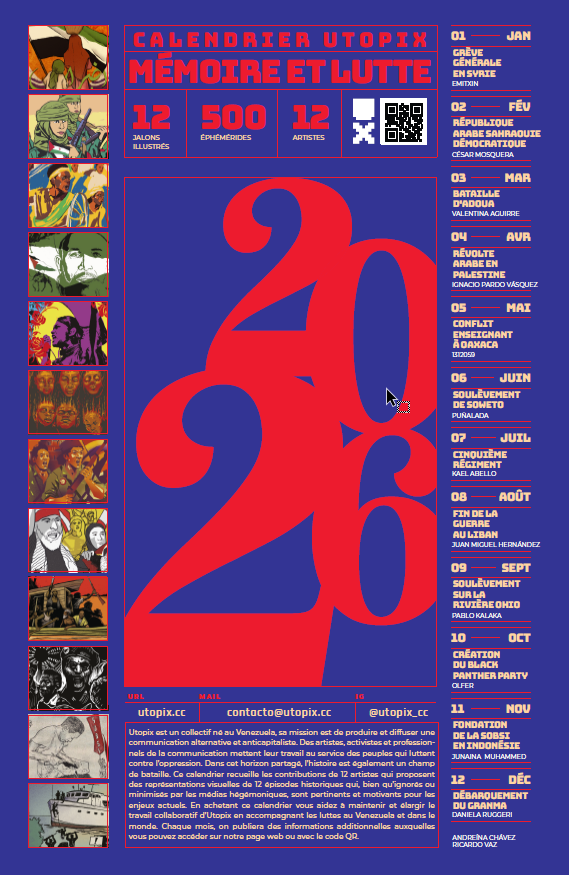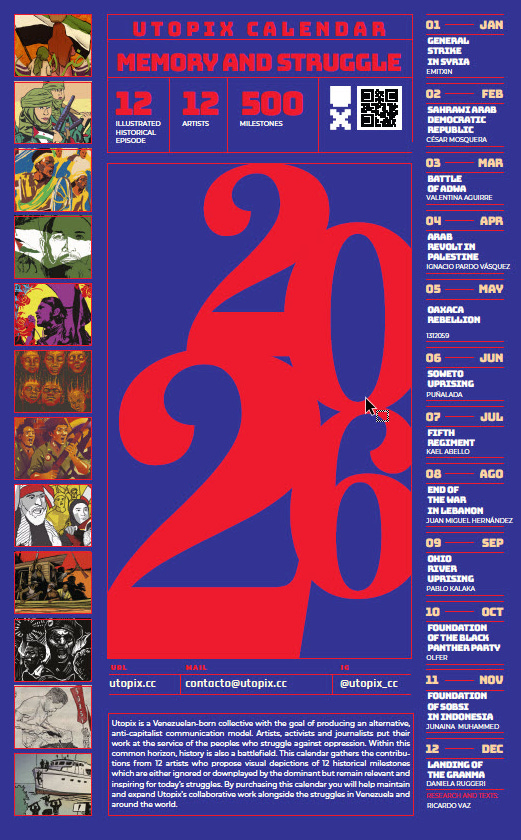Max Mansoubi, Walking Makes The Road, 30/7/2025
Max Mahmoud Mansoubi est un universitaire aujourd’hui retraité et vivant dans la Silicon Valley (Californie). Il a étudié à l'université de Florence, puis à l’université de Pise (Italie) où il a obtenu son doctorat. Il a mené des activités d’enseignement et de recherche dans diverses universités et institutions privées italiennes. Au cours de sa longue carrière, qui a débuté au milieu des années 1970, il a également été journaliste, critique de cinéma, animateur de radio, chroniqueur, éditeur de livres universitaires, architecte logiciel, directeur de réseau et de centre de données, fondateur de start-up, directeur technique et PDG.
Le monde
connaît actuellement de profondes transformations catalysées par les
technologies numériques, en particulier l’IA. Le développement de l’intelligence
artificielle générale (IAG) et la possibilité théorique d’une superintelligence
ajoutent de nouvelles dimensions à la dynamique du pouvoir mondial. Ces
technologies n’émergent pas de manière isolée, mais s’inscrivent dans un
système mondial caractérisé par la diminution de la souveraineté des
États-nations, l’intensification de l’interdépendance économique et la
complexité des systèmes de gouvernance transnationaux, dont elles sont
également le produit. Cette note de laboratoire soutient que l’IA et ses
itérations avancées jouent un rôle déterminant dans la reconfiguration du
pouvoir mondial et l’émergence de ce que l’on pourrait appeler l’impérialisme
postnational.
Cadre
théorique
Le pouvoir
passe des États-nations à des entités transnationales, une caractéristique
déterminante de la mondialisation. Comme l’ont fait valoir Saskia Sassen et
Manuel Castells, les paradigmes de la société en réseau et de la ville
mondiale révèlent comment le capital et l’influence circulent à travers les
frontières, remodelant l’autorité des États. La théorie des souverainetés
qui se chevauchent de David Held et le concept de réalisme cosmopolite
d’Ulrich Beck fournissent des éléments essentiels pour comprendre cette
évolution.
Le
déterminisme technologique, en particulier dans sa forme douce, suggère que la
technologie façonne les résultats sociaux sans les déterminer de manière
rigide. La théorie critique de la technologie d’Andrew Feenberg met l’accent
sur la co-construction de la technologie et de la société. L’IA, l’IAG et la Superintelligence
doivent être considérées comme des systèmes sociotechniques, c’est-à-dire qu’elles
évoluent grâce aux interactions entre les possibilités [« affordances »]
technologiques et les acteurs sociaux.
Le concept d’«
Empire » de Michael Hardt et Antonio Negri est essentiel. Dans cette optique, l’impérialisme
ne consiste plus en une conquête territoriale, mais en l’imposition de systèmes
de contrôle et de valeurs par le biais du capitalisme mondial, des institutions
internationales et, désormais, des technologies numériques.
L’IA et
la restructuration du pouvoir mondial
Le
développement de l’IA est principalement impulsé par des entreprises
transnationales (par exemple Google, Meta, Microsoft, Tencent), des
institutions de recherche mondiales et des organismes de gouvernance
supranationaux. Ces acteurs transcendent les limites des États-nations et
forment un empire diffus et interconnecté. La propriété et le déploiement des
technologies d’IA contribuent à un nouveau mode d’influence qui n’est pas lié à
la géographie, mais aux flux de données, au contrôle algorithmique et aux
dépendances infrastructurelles.
Nick Couldry
et Ulises Mejias ont inventé le terme « colonialisme des données » pour
décrire l’extraction de l’expérience humaine comme matière première pour le
développement de l’IA. Ce phénomène reflète l’extraction coloniale classique,
mais s’effectue par des moyens numériques. La gouvernance algorithmique, qui
fonctionne souvent sans contrôle démocratique, permet une forme de contrôle
impérial dans laquelle les décisions qui affectent des milliards de personnes
sont prises par des systèmes opaques appartenant à un petit nombre d’entités.
L’IA permet
la capitalisation des connaissances, de l’information et des capacités
cognitives (capitalisme cognitif), où l’attention, l’interaction et même le
travail émotionnel des êtres humains sont exploités et monétisés. Le
déploiement de l’IA dans les plateformes de travail et les systèmes de
surveillance intensifie cette tendance, entraînant de nouvelles asymétries de
pouvoir et une restructuration de la dynamique du travail à l’échelle mondiale.
L’IAG et
l’horizon de la superintelligence : une nouvelle avant-garde impériale ?
L’IAG, en
tant que système capable d’effectuer toutes les tâches intellectuelles dont l’être
humain est capable, représente un bond qualitatif en matière de capacités
technologiques. Les acteurs qui contrôlent l’IAG auront une influence sans
précédent sur la production de connaissances, la prise de décision et,
éventuellement, la gestion des risques existentiels. L’IAG devient ainsi un
atout stratégique comparable à l’énergie nucléaire au XXe siècle.
Des
théoriciens comme Nick Bostrom affirment que les superintelligences, c’est-à-dire
des entités largement plus intelligentes que les humains, pourraient remodeler
la civilisation. Si elle était monopolisée par un seul acteur ou une seule
coalition, la superintelligence pourrait imposer un nouvel ordre impérial,
caractérisé non pas par la force brute, mais par une domination cognitive
totale. Il s’agirait d’un empire postnational, non gouverné par des humains,
mais peut-être par des intermédiaires machiniques.
La course au
développement de l’IAG est intrinsèquement géopolitique. La Chine, les USA et
les conglomérats technologiques transnationaux en sont les principaux acteurs.
La lutte porte moins sur la suprématie nationale que sur l’accès aux données d’entraînement,
aux infrastructures informatiques et à la marge de manœuvre réglementaire. Il
en résulte un passage d’une géopolitique
westphalienne à une géopolitique des plateformes.
Caractéristiques
des futures puissances impériales postnationales
Ces
puissances n’auront pas besoin d’armées terrestres ni de frontières
officielles. Le contrôle s’exercera par le biais de la dépendance aux
plateformes, des points d’étranglement des infrastructures (services cloud,
réseaux satellitaires, production de puces) et des cadres de gouvernance
numérique.
Les empires
futurs combineront des acteurs publics et privés, avec des frontières floues
entre le pouvoir des entreprises et celui de l’État. La responsabilité
juridique sera fragmentée et la gouvernance sera mise en œuvre par le biais de
conditions d’utilisation, d’algorithmes et d’organismes de normalisation.
Dans l’impérialisme
postnational, le contrôle des flux d’informations, guidé par l’IA et la curation
algorithmique, sera primordial. L’IA déploiera des technologies persuasives
avancées pour façonner le discours public, influençant les résultats
électoraux, le comportement des consommateurs et l’opinion publique grâce à des
messages personnalisés et à une présentation sélective de l’information. L’intégration
omniprésente de l’IA dans la vie quotidienne lui permet déjà de guider
subtilement la pensée et l’action collectives, servant ainsi les objectifs de
ceux qui contrôlent l’infrastructure informationnelle.
L’architecture
économique émergente sera fondamentalement remodelée par une centralisation
extrême du capital, des données et des capacités de production. Dans ce nouveau
paradigme, la valeur sera principalement générée non pas par les moyens
industriels traditionnels, mais par le contrôle et l’exploitation d’écosystèmes
d’IA sophistiqués. Cela englobe l’ensemble du cycle de vie de l’intelligence
artificielle : de la collecte et de la curation méticuleuses de vastes
quantités de données d’entraînement, en passant par le développement et le
perfectionnement de modèles d’IA avancés, jusqu’au déploiement d’applications
innovantes. L’objectif ultime dans ce cadre est la monétisation du travail
cognitif à une échelle sans précédent, transformant la production
intellectuelle humaine en une ressource marchandisée gérée et optimisée par l’IA.
L’avènement
de l’intelligence artificielle générale (AGI) ou de la superintelligence
inaugure une ère où les empires postnationaux pourraient redéfinir
fondamentalement leurs rôles, pour devenir des entités principalement axées sur
la gestion planétaire. Ce profond changement dépasse l’influence géopolitique
traditionnelle et englobe des domaines critiques tels que la modélisation
climatique sophistiquée, la gestion globale de la biosphère et l’atténuation
proactive des risques existentiels. La capacité même de ces IA avancées à
traiter de vastes ensembles de données, à prédire des tendances écologiques
complexes et à optimiser l’allocation des ressources confère à ces empires
émergents une autorité techno-morale. Cette autorité, qui découle de leurs
prouesses technologiques inégalées et de leur engagement en faveur du bien-être
mondial, devrait dépasser l’efficacité et l’influence des institutions
internationales existantes, souvent entravées par des intérêts nationalistes et
des inefficacités bureaucratiques. Dans ce paradigme futur, la gouvernance des
défis les plus urgents de la Terre ne relèverait plus uniquement de la
compétence des États-nations ou de leurs organisations intergouvernementales,
mais serait de plus en plus influencée et potentiellement dirigée par ces
entités postnationales technologiquement avancées.
Défis et
contre-forces
Les
tendances anti-impérialistes émergentes contre les forces centralisatrices de l’IA
comprennent l’IA open source, la gouvernance décentralisée des données et la
souveraineté numérique. Des technologies telles que la blockchain et l’apprentissage
fédéré soutiennent cette tendance en permettant une gestion transparente et
distribuée des données et une formation décentralisée des modèles d’IA,
atténuant ainsi les risques liés à la confidentialité et au contrôle. En fin de
compte, une surveillance démocratique de l’IA est essentielle pour garantir la
responsabilité, le développement éthique et une large participation, empêcher
la consolidation du pouvoir et garantir que l’IA serve les intérêts de la
société plutôt que de nouvelles formes d’impérialisme.
Les efforts
déployés par l’UE, l’UNESCO et la société civile pour établir des lignes
directrices éthiques et des contraintes juridiques en matière d’IA constituent
des tentatives pour lier le développement de l’IA aux normes démocratiques.
Cependant, leur application reste faible et fragmentée.
La
résistance culturelle à l’homogénéisation algorithmique, qui se manifeste dans
les mouvements indigènes pour la souveraineté des données et les critiques de
la conception occidentale de l’IA, remet en question les tendances
universalistes des empires postnationaux.
Conclusion
L’IA, l’IAG et la superintelligence ne sont pas de simples innovations technologiques, mais des éléments fondamentaux d’un nouvel ordre mondial. L’impérialisme post-national qu’elles engendrent se caractérise par un contrôle déterritorialisé, une gouvernance hybride, une domination épistémique et une concentration économique. Ces évolutions posent des défis importants aux conceptions traditionnelles de la souveraineté, de la citoyenneté et de la démocratie. Les futures recherches sociologiques devront s’interroger de toute urgence sur ces changements, en soulignant la nécessité de cadres inclusifs, éthiques et pluralistes qui empêchent l’émergence d’un ordre impérial médiatisé par le numérique.
Bibliographie
Beck, U., Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Aubier 2006
Bostrom, N., Superintelligence, Dunod, 2017
Castells, M., La société en réseaux : l’ère de l’information, Fayard, 1998
Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford University Press.
Feenberg, A. (1999). Questioning Technology. Routledge.
Hardt, M., & Negri, A.? Empire, 10/18, 2004
Held, D. (1995). Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford University Press.
Mezzadra, S., & Neilson, B. (2013). Border as Method, or, the Multiplication of Labor. Duke University Press.
Sassen, S. (2006). Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. Princeton University Press.
Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Polity Press.
UNESCO, Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, 2021
Zuboff, S., L’Âge du capitalisme de surveillance, Zulma, 2020