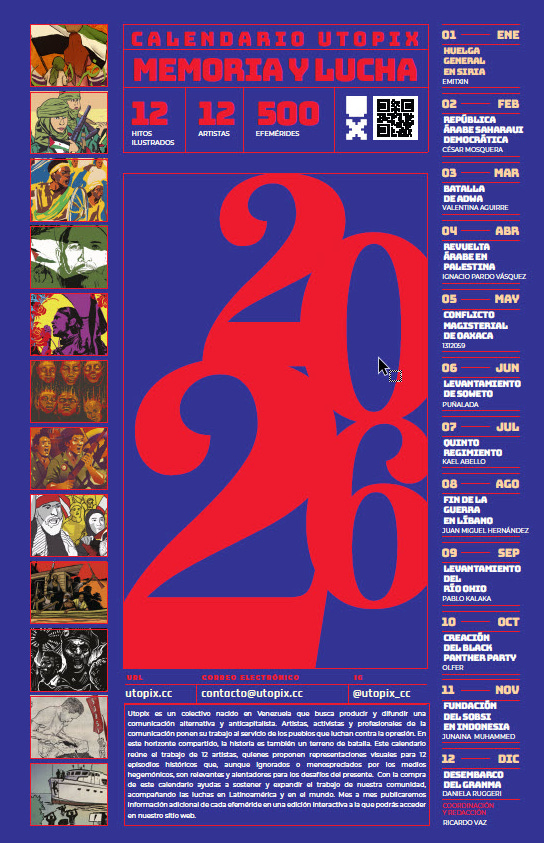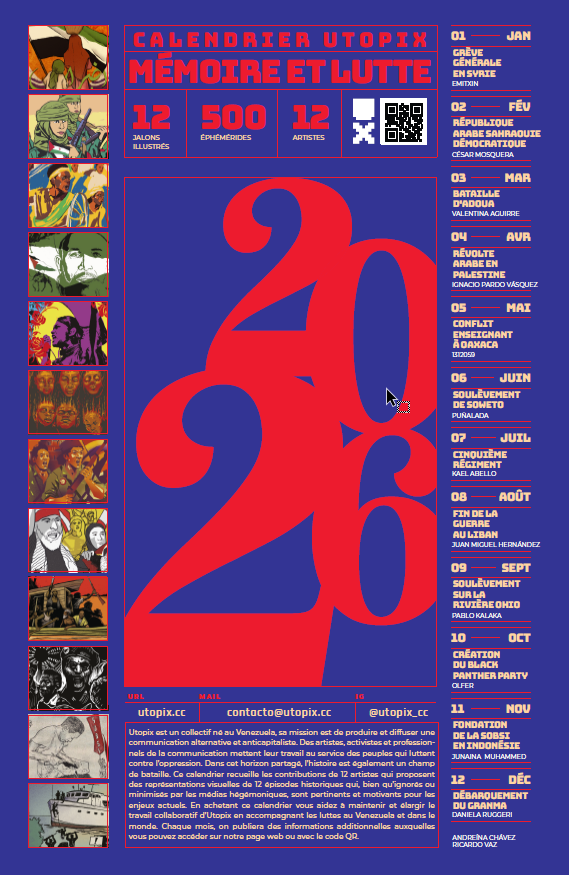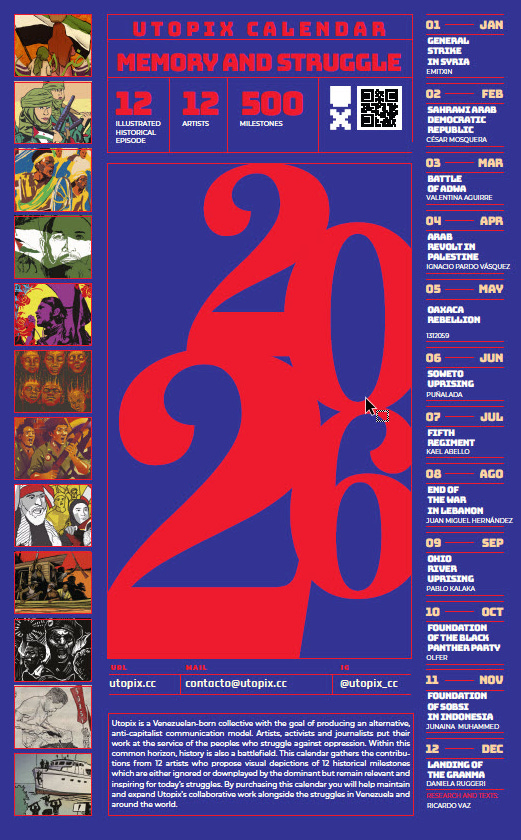Adieu
émouvant à Marah, morte en Italie victime du génocide
Une arme
infâme : La Palestinienne de 20 ans, arrivée de Gaza dans un état
désespéré, a été inhumée dans la province de Pise
Cérémonie
funéraire pourMarah Abou Zhouri, Palestinienne de 20 ans décédée à l’hôpital de
Pise. Photo Alessandro La Rocca/LaPresse
Giula Torrini, il manifesto,
21/8/2025
Traduit par Tlaxcala
« Marah
signifie joie, gaieté en arabe. C’est ce que ma fille transmettait. C’était ma
petite dernière, la plus jeune de ses cinq sœurs et de son frère qui m’attendent
maintenant à Gaza, où je veux retourner dès que je l’aurai enterrée ». La mère
de la Palestinienne de 20 ans dont la mort par malnutrition fait parler toute l’Italie
est petite, polie et enfermée dans une douleur très digne. Voilée, entièrement
vêtue de noir, elle porte un petit foulard palestinien que nous lui avons
offert ces derniers jours, lorsque nous l’avons rencontrée pour lui apporter la
solidarité de l’association « Un Ponte Per ».
Elle
parle très peu, protégée par ses proches venus du Portugal, de Belgique, du
Maroc et par la communauté palestinienne qui s’est précipitée de toute la
Toscane pour la soutenir lors des funérailles de sa fille, morte de faim et du
génocide.
Des
centaines de personnes ont assisté à la cérémonie dans le « parc de la Paix »
Tiziano Terzani de Pontasserchio, près de la commune de San Giuliano Terme,
dans la province de Pise. Une mer de drapeaux palestiniens et de keffiehs sous
un ciel humide et étouffant. De nombreux délégués des administrations de Pise
et des environs, avec leurs écharpes tricolores et leurs bannières, des
dizaines de journalistes, des caméras et des téléphones pour filmer le simple
cercueil en bois clair, posé sur un beau tapis brodé de rouge et d’or. Des
fleurs blanches, quelques tournesols et le drapeau de la Palestine recouvraient
le cercueil.
Arrivée
en Italie par un vol humanitaire, déjà affaiblie, épuisée par des jours de
marche et atteinte d’une leucémie suspectée puis démentie par les médecins
italiens, la jeune femme est décédée après moins de deux jours d’hospitalisation
à Pise. Aujourd’hui, son corps repose, enterré selon la tradition musulmane,
face à La Mecque, à côté du petit cimetière de San Giuliano Terme, où le maire
Matteo Cecchelli lui a offert une place. « Marah est arrivée en Italie trop
tard, tuée par la faim qui, pendant des mois, l’a empêchée de se nourrir
correctement, à cause du génocide en cours.
Les
institutions ne peuvent rester spectatrices : le gouvernement italien doit
reconnaître l’État palestinien et promouvoir des actions concrètes avec la
communauté internationale pour mettre fin à ce massacre », a-t-il déclaré.
Israël utilise la nourriture et l’eau comme des armes, dénonce la communauté
internationale depuis des mois.
Izzeddin
Elzir, imam de Florence, le rappelle également : « C’est pourquoi Marah est
arrivée en Italie dans un état de dénutrition avancé. Le couloir humanitaire
qui l’a mise en sécurité n’a pas suffi, car elle n’avait pas mangé depuis trop
longtemps. Dans la bande de Gaza, la nourriture est très rare, rationnée et de
mauvaise qualité. Quand j’entends parler de droit, je me demande : l’État d’Israël
n’a-t-il pas été créé par le droit international ? Si le droit international n’est
pas respecté, alors on pourrait dire qu’Israël n’existe pas non plus ». Les
applaudissements les plus forts et les chants du public s’élèvent sur les
accusations de complicité des États occidentaux, y compris l’Italie. « Nous
sommes tous complices, dit Luisa Morgantini, la vie vient de Gaza, et nous
devons défendre cette vie. Le peuple palestinien est fort, habitué depuis trop
longtemps à souffrir. C’est à nous qu’il revient de mener ce combat dans notre
vie quotidienne ».
Tandis
que la foule scande « Palestine libre » et applaudit les interventions du
président de la province de Pise et de la porte-parole de la nouvelle
ambassadrice de Palestine, Mona Abuamara, assise aux côtés de sa mère
visiblement émue, le président de la région, Eugenio Giani, fait son
apparition. Il prend la parole pour défendre les médecins toscans, les hôpitaux
de Florence, Pise et Massa, excellences italiennes dans le domaine des soins
aux mineurs, mais il est couvert par les sifflets et les chants. « Honte, assez
d’armes pour Israël, fermez les ports aux armes, bloquez la base militaire de
Coltano » sont quelques-uns des messages scandés. Mais Giani poursuit son
intervention en rappelant que la région Toscane a récemment approuvé une
résolution déclarant l’État de Palestine indépendant et souverain.
C’est à l’imam
de Pise, Mohammed Khalil, qu’il revient de conclure et de ramener le calme dans
un contexte qui, de cérémonie commémorative, s’est soudainement transformé en
arène politique, nous rappelant que la cause palestinienne passe aussi par des
choix politiques et partisans. « Ce n’est pas humanitaire de jeter de la
nourriture sur la tête des gens. Je me souviens de ma mère dans les années 70
qui tamisait la farine parce qu’elle était pleine de vers. Nous avons le devoir
de nous souvenir de Marah comme symbole de ce qui se passe à Gaza : la question
palestinienne n’est pas humanitaire, mais politique ».
Nous nous
rendons au cimetière pour la cérémonie d’enterrement. Et tandis que la terre
tombe peu à peu sur le cercueil de la jeune Marah, qui rêvait de manger enfin
un hamburger avec un Coca-Cola, qui coûte 50 dollars la canette à Gaza, le
visage de sa mère semble se détendre légèrement. « Demain, je retourne à Gaza.
Si je dois mourir, je mourrai sur ma terre. Je laisse ici en Italie une partie
de moi-même, ma Marah, ma joie. Je vous demande de prier pour elle, si vous le
pouvez ».
Marah Abou
Zhouri : le parquet a décidé de ne pas ouvrir d’enquête
Alessandra Annoni, Francesco B. Morelli, il manifesto, 21/8/2025
Traduit par Tlaxcala
Alessandra
Annoni est professeure de droit international à Ferrare, Francesco B. Morelli
est professeur de droit pénal procédural à Messine
« Nous ne
voyons aucun délit dans cette affaire ». C’est ainsi que, selon la presse, la
procureure de la République de Pise a justifié sa décision de ne pas ordonner l’autopsie
du corps de Marah Abou Zhouri, la jeune Palestinienne évacuée de la bande de
Gaza le 14 août et décédée à l’hôpital de Cisanello 36 heures après son
admission.
La femme
était arrivée à l’hôpital avec une suspicion de leucémie, déjà exclue par les
premiers examens diagnostiques ; elle pesait 35 kilos et présentait, selon les
médecins, un état général de déperdition organique. Marah venait d’un
territoire réduit en cendres par 22 mois de bombardements intensifs, dont le
système sanitaire a été complètement détruit et où, depuis des mois, l’entrée
et la distribution de l’aide humanitaire sont entravées de toutes les manières
possibles.
Le 29
juillet 2025, l’IPC Global Initiative, la principale autorité internationale en
matière de sécurité alimentaire, a publié un avis urgent pour signaler le
risque réel et imminent de famine dans la bande de Gaza. Depuis le début des
hostilités, les autorités sanitaires de Gaza ont documenté la mort par famine
de 235 personnes, dont 106 mineurs. Ce type de décès est en augmentation
exponentielle : 170 ont été recensés entre le 1er juillet et le 13
août. Comme l’a souligné à plusieurs reprises le secrétaire général de l’ONU,
cette situation n’est pas le résultat d’une catastrophe naturelle. Il ne s’agit
pas non plus d’une conséquence inévitable du conflit armé en cours. La famine à
Gaza est le résultat d’un comportement humain.
Pourtant,
selon le parquet de Pise, la mort de Marah ne serait pas liée à une hypothèse
de crime méritant une enquête. Il faut donc exclure que cette femme ait été
victime d’un génocide, un crime pourtant prévu par notre législation (article 1
de la loi 962 de 1967). La Cour internationale de justice avait déjà jugé
plausible le risque de génocide à Gaza en janvier 2024 et avait intimé à Israël
de lever tous les obstacles à l’entrée de l’aide humanitaire ; de nombreux
experts ont désormais conclu qu’Israël commet un génocide, mais pour le parquet
de Pise, cette hypothèse de crime ne mérite pas d’être approfondie.
Le
parquet lui-même a manifestement estimé pouvoir exclure également la commission
d’infractions « communes » qui, selon les informations et les faits révélés,
auraient pu être envisagées : l’homicide volontaire ou involontaire ; la
torture, en supposant que la victime ait été contrainte de subir des
souffrances physiques et psychiques alors qu’elle se trouvait certainement dans
un état de défense réduite, à la merci des bombes, sans nourriture ni
médicaments. Enfin, la mort comme conséquence d’un autre crime. Il s’agit de
crimes sur lesquels les autorités italiennes auraient eu pleine compétence,
même s’ils résultent d’actes commis à l’étranger : Marah est décédée en Italie
et, conformément à l’article 6 du code pénal, cela suffit pour considérer que
le crime a été commis sur le territoire italien.
La
déclaration de la procureure Camelio rapportée par la presse doit être évaluée
dans le contexte de la Constitution et du code de procédure pénale. Pour que l’enquête
puisse commencer, il n’est pas nécessaire que le procureur identifie un délit
avant d’avoir effectué tout acte d’enquête. Ce qui doit ressortir, c’est une
information relative à un délit, c’est-à-dire « la représentation d’un fait,
déterminé et non invraisemblable, pouvant être rattaché à une infraction pénale
» (article 335 du code de procédure pénale). Comme nous l’avons vu, ces
éléments ne manquent pas. Et les éléments qui fondent une hypothèse concrète d’infraction
ne manquent pas non plus. Les médecins italiens ont nié l’existence de la
leucémie qui aurait été diagnostiquée ailleurs. Nous savons de la bouche même
des professionnels de santé que le décès est survenu à la suite d’un « grave
dépérissement organique », intuitivement attribuable à la malnutrition.
Nous
savons que dans la bande de Gaza, l’entrée et la distribution de nourriture
dans des conditions de sécurité sont interdites. Il s’agit là d’éléments
factuels qui révèlent que la mort de Marah est très probablement imputable à
des comportements d’autres personnes et non à des pathologies indépendantes de
celles-ci, ce qui ne peut que justifier la nécessité d’une enquête.
L’obligation
de poursuivre ne prétend pas qu’un délit soit diagnostiqué avec certitude au
moment où il est signalé. Ce principe constitutionnel exige plutôt que les
enquêtes nécessaires soient menées afin de déterminer si les indices qui
fondent l’hypothèse d’un délit peuvent aboutir à sa constatation à l’issue d’un
procès. La procureure aurait dû procéder à l’audition des médecins qui ont
soigné la victime, de ses parents, à l’acquisition du diagnostic établi
ailleurs et de tous les éléments nécessaires pour faire la lumière sur le
comportement et ses responsables ; mais avant tout, l’autopsie, qui aurait pu
attester la ou les causes du décès. La présence même d’autres maladies non
diagnostiquées n’exclut pas l’infraction, car la maladie aurait pu provoquer la
mort, telle qu’elle s’est produite, uniquement en présence de conditions,
créées par d’autres, de malnutrition et d’absence de soins.